Corps racialisés, délinquance et territoires de l’invisibilité: l’espace comme vecteur de domination symbolique
Une analyse des processus sociaux par lesquels les espaces publics et institutionnels produisent et reflètent des hiérarchies identitaires et racialisantes, en articulant mécanismes d’inclusion, d’exclusion et formes transgressives d’affirmation…
L’espace agit comme un champ structuré, traversé par des rapports de force où se rejoue la distribution du capital symbolique et social. Dans ce contexte, la race, loin d’être un simple critère identitaire, devient une catégorie socialement construite, qui s’inscrit différemment dans l’habitus des dominants et des dominés: pour les dominants, elle peut servir d’outil de distinction et de légitimation des hiérarchies sociales, tandis que pour les dominés, elle est souvent intériorisée comme une marque d’exclusion ou de stigmatisation.
À l’intérieur de cette dynamique, l’espace façonne et reflète ces manières d’être ontologiquement prégnantes: il rend certains corps légitimes, d’autres déplacés ou illégitimes. Être (in)visible dans l’espace, c’est être positionné dans une hiérarchie implicite qui organise la reconnaissance sociale. Ainsi, la relation entre race et espace traduit une violence symbolique intériorisée, naturalisée. Ce n’est pas seulement «qui» occupe l’espace, mais comment et avec quelle légitimité.
Il faut donc comprendre la notion de race, du point de vue sociologique. C’est-à-dire une construction sociale plutôt qu’une réalité biologique. Dès lors, la race sert à catégoriser les individus en fonction de caractéristiques physiques perçues mais surtout elle structure des relations de pouvoir, d’inégalités et de discrimination dans la société. La lecture sociologique met en lumière comment la race est utilisée pour justifier des hiérarchies sociales, des exclusions, et des stigmatisations, influençant ainsi les identités, les rapports sociaux et les politiques. On parle d’ailleurs «des personnes racisées» qui met justement l’accent sur le fait que la race n’est pas une donnée biologique naturelle mais une construction sociale qui attribue à certains groupes des catégories et des stéréotypes, souvent associés à des discriminations ou à des marginalisations.
Autrement dit, la race ne dit pas simplement qui sont les individus, mais surtout comment ils sont perçus, traités et situés dans l’ordre social. En tant que signifiant catégoriel inscrit dans l’habitus, elle agit comme un opérateur de classement, un principe invisible mais puissant de différenciation et de reproduction des inégalités.
Dans cette perspective, la race s’inscrit dans l’habitus ; concept sociologique qui désigne un système de dispositions durables et transposables, incorporées par les individus au cours de leur socialisation. L’habitus oriente les manières de percevoir, de penser et d’agir sans passer par la conscience ou la volonté explicite. Il est façonné par la position occupée dans l’espace social et, en retour, contribue à reproduire les structures sociales existantes.
Ainsi, la race, en tant que catégorie produite et reproduite par l’histoire coloniale, les rapports de domination, les institutions et les pratiques sociales, s’inscrit dans l’habitus de manière différenciée selon la position des individus dans le champ social. Pour les dominants, elle tend à être mobilisée - souvent de manière implicite - comme un principe de distinction, de hiérarchisation ou d’exclusion, participant à la naturalisation des inégalités. Pour les dominés, elle peut être vécue comme une assignation identitaire, intériorisée sous forme de stigmate, de malaise ou de conscience aiguë de leur altérisation sociale.
Dans les deux cas, la race fonctionne comme un schème de perception incorporé, qui structure les rapports sociaux sans nécessairement passer par un discours explicite.
En outre, la visibilité n’est pas synonyme de reconnaissance ni de pouvoir. Elle peut, au contraire, être une forme de surexposition stigmatisante. Cette visibilité des corps racisés dans l’espace social ne signifie pas inclusion mais assignation à une place dominée, souvent perçue comme illégitime. Autrement dit, les personnes racisées sont visibles mais pas de la bonne manière dans les yeux de l’ordre dominant: elles sont rendues hypervisibles quand elles dérogent à la norme (dans l’espace public, dans les institutions…), et invisibles dans les lieux de pouvoir, de décision, de prestige. C’est cette double peine de visibilité suspecte et d’invisibilité politique que produit l’espace social.
Les structures sociales imposent une perception du monde où certains corps apparaissent comme «à leur place» et d’autres comme «hors-place» ou «mal placé», engendrant malaise, rejet ou peur. L’espace n’est donc pas seulement géographique, il est un miroir des habitus et des dominations incorporées. L’assignation spatiale des personnes racisées repose souvent sur un regard essentialisant: leurs présences visibles dans certains lieux sont perçues non comme le fruit d’une histoire sociale mais comme l’expression d’une essence supposée dangereuse, inadaptée ou étrangère. Ce glissement essentialiste masque les rapports de pouvoir en les naturalisant. Il fige les individus dans des identités closes, comme si leur appartenance raciale déterminait naturellement leur «place» dans l’espace social.
Cette logique résonne avec la violence symbolique: elle pousse les dominés à intérioriser leur illégitimité dans certains lieux ou rôles. Ainsi, l’espace devient un outil de différenciation essentialisante, où la visibilité des corps racisés confirme leur altérité plus qu’elle ne reconnaît leur humanité. Cet axiome prend une portée particulièrement incisive dans le contexte européen, souvent présenté, à tort, comme «post-racial» ou «aveugle à la race».
Cette prétention à l’universalisme ou à l’égalité abstraite, car prétendument vacciné contre toute forme de ségrégationnisme structurel, masque en réalité des formes persistantes et renouvelées de racialisation. Sous cet angle, la race n’est pas niée dans ses effets mais simplement refoulée dans les discours officiels, ce qui empêche de nommer les discriminations ou les exclusions. Les corps racisés deviennent alors hypervisibles dans les espaces publics, lorsqu’ils sont perçus comme perturbateurs et non assimilés, et invisibilisés dans les sphères de pouvoir, de culture dominante ou de savoir.
Du reste, la lecture essentialiste de ce phénomène permet de dévoiler cette contradiction. Au sens où le champ social européen continue d’exercer une violence symbolique racialisée, tout en prétendant s’en être affranchi. L’essentialisation raciale, dans un contexte officiellement post-racial, devient d’autant plus perverse qu’elle s’exerce sans aveu. Ce déni empêche toute action véritable sur les structures, et conforte les dominants dans une forme de bonne conscience universaliste, alors même que l’espace social - et ses moult composantes - reste profondément inégalitaire.
En Belgique, le mythe d’une société post-raciale et égalitaire dissimule assez mal la réalité des discriminations structurelles qui frappent les personnes racisées. Bien que les droits fondamentaux soient proclamés universels et inaltérables, leur mise en œuvre est différenciée selon l’espace social et la racialisation des individus. Dans le logement, l’emploi, l’enseignement ou les interactions avec la police, les inégalités s’accumulent et se perpétuent sous couvert de neutralité. L’espace urbain lui-même devient un théâtre de hiérarchisation raciale: certains quartiers sont stigmatisés comme «zones à problème», tandis que leurs habitants, souvent racisés, y sont enfermés par des mécanismes d’exclusion et invisibilisés dans les processus de décision mais survisibilisés aux yeux du contrôle social.
Cette essentialisation spatiale des populations produit une forme de ségrégation insidieuse non formelle, qui rend les droits humains théoriques inopérants. Il faut néanmoins souligner que les problèmes de délinquance, de déviance ou de transgression existent bel et bien. Il ne s’agit ni de les nier ni de les minimiser. Mais pour comprendre ces phénomènes, il faut éviter les raccourcis qui établissent un lien automatique entre origine racisée et comportement problématique ou infractionnel. Un lien qui, bien souvent, repose sur des perceptions biaisées et des généralisations dangereuses.
En effet, certaines zones urbaines concentrent plus de délits. Mais cela s’explique moins par l’origine des habitants que par des facteurs structurels: pauvreté persistante, accès inégal aux ressources éducatives, marginalisation économique, discriminations à l’embauche, stigmatisation sociale. Cela signifie que la délinquance n’est pas une «culture» importée, mais un symptôme de fractures sociales profondes.
En Belgique comme ailleurs, les personnes racisées surtout plus jeunes sont aussi plus souvent ciblées par les contrôles, plus exposées aux sanctions pénales, et moins protégées par les filets sociaux. Cela crée un cercle vicieux: plus de contrôles, plus d’arrestations, donc plus de statistiques associées à certains groupes, ce qui alimente les préjugés, sans pour autant traiter les causes réelles. Donner à comprendre les actes délictueux ou les conduites transgressives n’excuse en rien leur existence et les désagréments inhérents engendrés par ces manifestations problématiques, mais cela n’autorise pas non plus à l’expliquer de manière réductrice par l’unique prisme essentialiste.
Penser ces phénomènes implique de les inscrire dans une analyse globale des politiques publiques, souvent productrices ou amplificatrices d’inégalités sociales, raciales et territoriales. L’aménagement urbain, les politiques sécuritaires ou éducatives, l’inadéquation des politiques culturelles participent à une reproduction structurelle des exclusions, qui ne peut être comprise sans interroger les logiques historiques et institutionnelles en jeu.
Il s’agit aussi de reconnaître les effets de domination cumulative, où la race, la classe et le territoire s’articulent. Toutefois, pour éviter une lecture purement victimaire, cette réflexion doit inclure la capacité d’agir des personnes racisées, leurs formes de résistance, de création et d’appropriation de l’espace. Cela engage une responsabilité collective, mais aussi des dynamiques d’émancipation portées par les premiers concernés.
Dès lors, comment penser des réponses politiques équilibrées, qui reconnaissent à la fois les effets systémiques de la racialisation et le devoir de responsabilité individuelle, y compris chez les personnes racisées, face à des comportements déviants ou violents?
Pour répondre à la délinquance sans tomber dans la stigmatisation raciale, les politiques publiques doivent conjuguer responsabilisation individuelle et prise en compte des inégalités structurelles. Cela passe par une application équitable de la loi, sans excuser les actes violents mais sans essentialiser les groupes racisés. Les forces de l’ordre, la justice et l’école doivent être formées à reconnaître et corriger leurs biais systémiques.
En parallèle, des actions ciblées sur les quartiers vulnérables (emploi, éducation, médiation culturelle et cultuelle) permettent d’agir sur les causes profondes. La mise en avant de rôles modèles issus de ces milieux et le développement de mécanismes de justice restaurative renforcent l’idée que chacun peut et doit faire des choix responsables, tout en étant soutenu dans son parcours. Il s’agit d’articuler exigence civique et réparation sociale, plutôt que de les opposer.
En somme, penser les transgressions dans l’espace social en contexte de racialisation, c’est refuser de les réduire à un simple dysfonctionnement individuel ou moral. C’est comprendre que les actes sont inscrits dans des trajectoires façonnées par des rapports sociaux inégalitaires, où la race, la classe et l’espace produisent des formes d’existence contraintes, souvent marquées par la relégation, la précarité et la stigmatisation. Les personnes racisées ne naissent pas «déviantes»: elles sont assignées à des places où la marge devient parfois la seule scène possible de visibilité, d’action ou de contestation.
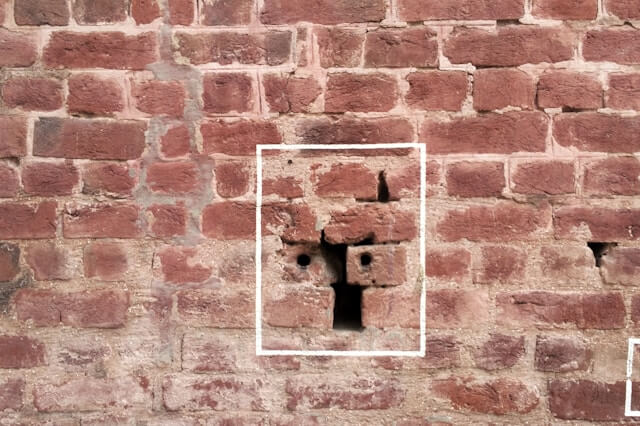
Rejeter cette assignation, c’est initier un geste d’émancipation, un refus de l’étiquette imposée, une tentative de reconfiguration du rapport à soi et au monde. Mais cette émancipation ne peut être portée uniquement par les individus, elle suppose une transformation radicale des structures, une justice qui ne se contente pas de punir mais qui interroge les conditions matérielles et symboliques de la vie digne. Dans ce cadre, les luttes des personnes racisées ne sont pas des écarts mais des affirmations politiques de leur droit à exister autrement que dans l’ombre du soupçon.
Néanmoins, cela ne doit pas légitimer les actes délictueux d’affirmation de soi mais plutôt inviter à les décrypter comme des signaux politiques d’un désajustement profond entre les normes sociales dominantes et les réalités vécues par les personnes racisées. Il ne s’agit ni de les excuser ni de les essentialiser mais de reconnaître que certaines transgressions expriment, à leur manière, une quête de reconnaissance, de dignité ou de pouvoir d’agir là où les voies légitimes sont obstruées.
L’enjeu est donc de construire des conditions sociales, éducatives, culturelles et politiques permettant des formes d’affirmation de soi hors du cadre de la marginalisation ou de la répression, en ouvrant des espaces réels d’expression, de participation et de transformation. La justice véritable ne se contente pas de condamner les actes: elle s’attache à comprendre ce qui les rend possibles et à rendre possible autre chose.
Nonobstant, soyons de bon compte, ces actes transgressifs ne sont pas majoritaires dans les populations racisées et circonscris uniquement aux lieux où elles résident le plus souvent ; à avoir les quartiers populaires. Ces comportements enfreignant le cadre autorisé ne représentent d’ailleurs qu’une minorité marginale, souvent surmédiatisée et instrumentalisée dans les discours publics. Les personnes racisées dans une large proportion vivent, travaillent et contribuent à la société sans recours à de telles conduites. Ces actes, bien que réels, doivent être compris comme des symptômes isolés d’un mal-être social largement partagé, mais pas uniformément exprimé. Insister sur leur caractère minoritaire permet de déconstruire les stéréotypes réducteurs et d’éviter la criminalisation collective, tout en soulignant l’urgence d’agir sur les causes structurelles qui peuvent conduire à ces situations.
Ils sont l’expression ponctuelle d’un contexte marqué par des inégalités structurelles, des discriminations répétées et des exclusions socio-spatiales. Plutôt que de stigmatiser ces comportements comme révélateurs d’une «nature» ou d’une essence déviante, il convient de les situer dans un cadre plus large, celui des luttes quotidiennes pour la reconnaissance, la dignité et la justice sociale. C’est en investissant dans des politiques publiques inclusives et en valorisant les capacités d’action des personnes racisées que l’on peut espérer réduire ces fractures, tout en favorisant une société plus égalitaire et respectueuse de la pluralité des existences.
